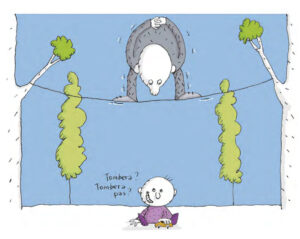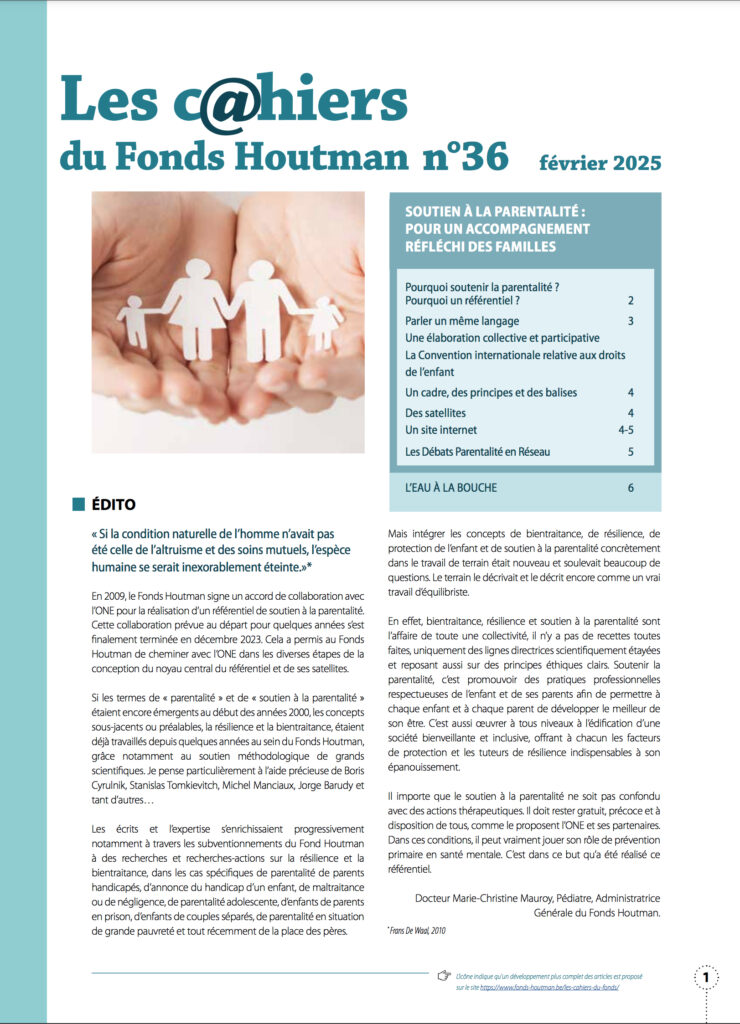Pour aller plus loin...
Soutien à la parentalité : Pour un accompagnement réfléchi des familles
Rédigé il y a quinze ans environ par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), l’Administration de l’Aide à la Jeunesse et le Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) – et avec le soutien du Fonds Houtman, le Référentiel de soutien à la parentalité continue d’orienter les pratiques de terrain. Ce document est destiné aux professionnels en contact direct ou indirect avec les familles. Il pose des balises éthiques et des repères pédagogiques afin de promouvoir des pratiques professionnelles respectueuses de l’enfant et de ses parents. Il permet également le développement d’un langage commun autour du soutien à la parentalité et favorise les pratiques de réseau. Il s’accorde avec le plan global de soutien à la parentalité mûri dès 2006 par Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de l’époque, qui prévoyait différentes actions, dont un document qui permettrait à l’ensemble des professionnels de la Fédération d’avoir des références communes et un outil pour partager sur ce concept de soutien à la parentalité.
Quelques figures présentes dès le début du processus ou qui en assurent aujourd’hui la continuité reviennent sur la genèse de ce texte de référence, sur ses principes directeurs et partagent leur engagement pour le soutien et l’accompagnement des parents dans l’exercice de leur parentalité, dans le respect des droits de l’enfant.
- Myriam Sommer, Directrice de la Direction Recherche et Développement de l’0NE jusqu’en 2010 (avant Service Etudes et Stratégies).
- Geneviève Bazier, Directrice actuelle de la Direction Recherche et Développement de l’ONE.
- Marie Thonon, Référente en intersectorialité pour le secteur de l’Aide à la Jeunesse. Lors de la création du référentiel, elle travaillait à l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse, à la Direction SAJ/SPJ et était en charge des collaborations avec l’ONE.
- Stephan Durviaux, Criminologue, Conseiller alors auprès du Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE).
- Nathalie Van Cauwenberghe, Criminologue auprès du Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE), Cellule plainte et médiation institutionnelle.
- Virginie Pasqua, Aurélie Dupont et Eleonora Bianchi, Gestionnaires de Projets et Membres de la Cellule Soutien à la parentalité de l’ONE.
Edito
Par le Docteur Marie-Christine Mauroy, Pédiatre, Administratrice Générale du Fonds Houtman.
« Si la condition naturelle de l’homme n’avait pas été celle de l’altruisme et des soins mutuels, l’espèce humaine se serait inexorablement éteinte »*
En 2009, le Fonds Houtman signe un accord de collaboration avec l’ONE pour la réalisation d’un référentiel de soutien à la parentalité. Cette collaboration prévue au départ pour quelques années s’est finalement terminée en décembre 2023. Cela a permis au Fonds Houtman de cheminer avec l’ONE dans les diverses étapes de la conception du noyau central du référentiel et de ses satellites.
Si les termes de « parentalité » et de « soutien à la parentalité » étaient encore émergents au début des années 2000, les concepts sous-jacents ou préalables, la résilience et la bientraitance, étaient déjà travaillés depuis quelques années au sein du Fonds Houtman, grâce notamment au soutien méthodologique de grands scientifiques. Je pense particulièrement à l’aide précieuse de Boris Cyrulnik, Stanislas Tomkievitch, Michel Manciaux, Jorge Barudy et tant d’autres…
Les écrits et l’expertise s’enrichissaient progressivement notamment à travers les subventionnements du Fond Houtman à des recherches et recherches-actions sur la résilience et la bientraitance, dans les cas spécifiques de parentalité de parents handicapés, d’annonce du handicap d’un enfant, de maltraitance ou de négligence, de parentalité adolescente, d’enfants de parents en prison, d’enfants de couples séparés, de parentalité en situation de grande pauvreté et tout récemment de la place des pères.
Mais intégrer les concepts de bientraitance, de résilience, de protection de l’enfant et de soutien à la parentalité concrètement dans le travail de terrain était nouveau et soulevait beaucoup de questions. Le terrain le décrivait et le décrit encore comme un vrai travail d’équilibriste.
En effet, bientraitance, résilience et soutien à la parentalité sont l’affaire de toute une collectivité, il n’y a pas de recettes toutes faites, uniquement des lignes directrices scientifiquement étayées et reposant aussi sur des principes éthiques clairs. Soutenir la parentalité, c’est promouvoir des pratiques professionnelles respectueuses de l’enfant et de ses parents afin de permettre à chaque enfant et à chaque parent de développer le meilleur de son être. C’est aussi œuvrer à tous niveaux à l’édification d’une société bienveillante et inclusive, offrant à chacun les facteurs de protection et les tuteurs de résilience indispensables à son épanouissement.
Il importe que le soutien à la parentalité ne soit pas confondu avec des actions thérapeutiques. Il doit rester gratuit, précoce et à disposition de tous, comme le proposent l’ONE et ses partenaires. Dans ces conditions, il peut vraiment jouer son rôle de prévention primaire en santé mentale. C’est dans ce but qu’a été réalisé ce référentiel.
* (Frans De Waal, 2010).
1. « La parentalité est de plus en plus difficile à assumer »
Myriam Sommer, Directrice de la Direction Recherche et Développement de l’0NE jusqu’en 2010 (avant Service Etudes et Stratégies).
Dans quel contexte est né le Référentiel de soutien à la parentalité ?
Le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance a redessiné ses missions, dans lesquelles s’inscrit désormais celle, transversale, de soutien à la parentalité, au côté de l’accueil et de l’accompagnement. Dans sa note du 6 juin 2006, le gouvernement de la Communauté française/Fédération Wallonie-Bruxelles invitait également l’ONE, vu son expérience en la matière, à construire un référentiel de soutien à la parentalité en précisant que celui-ci devait dépasser sa sphère d’action pour s’adresser à tous les professionnels concernés. En pratique, dans le secteur des milieux d’accueil, une démarche largement participative, avec une vingtaine d’experts tant des universités que du terrain, avait déjà permis la réalisation d’un référentiel, pour l’accueil[1]. Il était conçu comme un outil destiné aux professionnels, agençant des connaissances, des valeurs et des repères que chacun devait pouvoir s’approprier et adapter à son contexte.

Le contrat de gestion de l’ONE 2008-2012 a intégré encore davantage la notion de référentiel, qui a été soutenu par le Fonds Houtman dans sa version dédiée au soutien à la parentalité. Des brochures « satellites » sont ensuite venues décliner l’apport du premier document-noyau. Concernant le contexte social, l’idée que les parents délèguent de plus en plus leurs missions aux institutions éducatives alimentait depuis une trentaine d’années le thème de la démission parentale. Le soutien à la parentalité apparaissait comme un rappel à l’ordre des parents. Mais, dans les faits, les initiatives de soutien à la parentalité qui ont émergé ont souvent une visée émancipatrice et contribuent à rompre l’isolement dans lequel vivent certaines familles.
[1] MANNI Gentile coord. (2002). Accueillir les tout-petits, oser la qualité. Un référentiel psychopédagogique pour des milieux d’accueil de qualité. Bruxelles, ONE-Fonds Houtman.
Comment ce référentiel de soutien à la parentalité a-t-il été conçu ?
Sa mise en place a mobilisé tout le secteur. Les TMS de l’ONE (aujourd’hui PEP’s – Partenaires Enfants-Parents) ont participé à des ateliers avec des professionnels des milieux d’accueil et des services de l’Aide à la Jeunesse autour de cinq thèmes majeurs qui faisaient écho à leurs pratiques : le partenariat parents-professionnels, les vulnérabilités, l’attachement, les repères et les limites, les activités de l’enfant et/ou pour l’enfant. L’objectif de ces journées était d’enrichir la réflexion grâce à des clés de lectures proposées par des experts de disciplines diverses et de faire ressortir les défis, les questionnements, les principes communs, les concepts utiles. Pour chaque question, ces ateliers ont ramené les idées maîtresses partagées par les participants. Le processus a duré un an et demi et six cents professionnels concernés par la petite enfance et la périnatalité y ont contribué : consultations prénatales, consultations pour enfants, milieux d’accueil, initiatives émanant de l’Aide à la Jeunesse, services spécialisés de la petite enfance (SASPE)… C’est sur base de ce matériau que l’ONE, le Délégué général aux droits de l’enfant et l’Aide à la Jeunesse ont donné forme au référentiel.
Dans quel contexte est né le Référentiel de soutien à la parentalité ?
Le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de l’Enfance a redessiné ses missions, dans lesquelles s’inscrit désormais celle, transversale, de soutien à la parentalité, au côté de l’accueil et de l’accompagnement. Dans sa note du 6 juin 2006, le gouvernement de la Communauté française/Fédération Wallonie-Bruxelles invitait également l’ONE, vu son expérience en la matière, à construire un référentiel de soutien à la parentalité en précisant que celui-ci devait dépasser sa sphère d’action pour s’adresser à tous les professionnels concernés. En pratique, dans le secteur des milieux d’accueil, une démarche largement participative, avec une vingtaine d’experts tant des universités que du terrain, avait déjà permis la réalisation d’un référentiel, pour l’accueil[1]. Il était conçu comme un outil destiné aux professionnels, agençant des connaissances, des valeurs et des repères que chacun devait pouvoir s’approprier et adapter à son contexte. Le contrat de gestion de l’ONE 2008-2012 a intégré encore davantage la notion de référentiel, qui a été soutenu par le Fonds Houtman dans sa version dédiée au soutien à la parentalité. Des brochures « satellites » sont ensuite venues décliner l’apport du premier document-noyau. Concernant le contexte social, l’idée que les parents délèguent de plus en plus leurs missions aux institutions éducatives alimentait depuis une trentaine d’années le thème de la démission parentale. Le soutien à la parentalité apparaissait comme un rappel à l’ordre des parents. Mais, dans les faits, les initiatives de soutien à la parentalité qui ont émergé ont souvent une visée émancipatrice et contribuent à rompre l’isolement dans lequel vivent certaines familles.
[1] MANNI Gentile coord. (2002). Accueillir les tout-petits, oser la qualité. Un référentiel psychopédagogique pour des milieux d’accueil de qualité. Bruxelles, ONE-Fonds Houtman.
Comment ce référentiel de soutien à la parentalité a-t-il été conçu ?
Sa mise en place a mobilisé tout le secteur. Les TMS de l’ONE (aujourd’hui PEP’s – Partenaires Enfants-Parents) ont participé à des ateliers avec des professionnels des milieux d’accueil et des services de l’Aide à la Jeunesse autour de cinq thèmes majeurs qui faisaient écho à leurs pratiques : le partenariat parents-professionnels, les vulnérabilités, l’attachement, les repères et les limites, les activités de l’enfant et/ou pour l’enfant. L’objectif de ces journées était d’enrichir la réflexion grâce à des clés de lectures proposées par des experts de disciplines diverses et de faire ressortir les défis, les questionnements, les principes communs, les concepts utiles. Pour chaque question, ces ateliers ont ramené les idées maîtresses partagées par les participants. Le processus a duré un an et demi et six cents professionnels concernés par la petite enfance et la périnatalité y ont contribué : consultations prénatales, consultations pour enfants, milieux d’accueil, initiatives émanant de l’Aide à la Jeunesse, services spécialisés de la petite enfance (SASPE)… C’est sur base de ce matériau que l’ONE, le Délégué général aux droits de l’enfant et l’Aide à la Jeunesse ont donné forme au référentiel.
Le référentiel se limite à quelques éléments. Un choix mûri ?
C’était l’idée d’une vision globale et repères plutôt que de normes, avec la possibilité par la suite de donner lieu à des compléments en fonction de besoins spécifiques. Le référentiel contient une introduction sur le contexte de et la manière dont il a été élaboré collectivement, puis la définition de ce que l’on entend par référentiel et, dans ce cadre, la définition du soutien à la parentalité. Quatre grands principes ont été définis : l’enfant est au cœur du soutien à la parentalité, les parents ont des compétences, le soutien à la parentalité s’adresse à tous les parents, et la prise en compte des contextes de vie est absolument nécessaire. Le document contient également une « grille d’intelligibilité des actions d’accompagnement de la parentalité ». Il s’agit d’un outil qui permet un temps d’arrêt par rapport à une situation familiale. La grille peut éclairer les professionnels en les aidant à se positionner, seuls ou en concertation avec d’autres acteurs, en facilitant le dialogue entre intervenants sur base d’un langage commun. Puisque cela doit s’adresser à tout le monde et à toutes les situations, il s’agit de principes généraux. D’où l’idée de développer des satellites relatifs à des situations plus spécifiques, comme le soutien à la parentalité dans les milieux d’accueil par exemple ou l’accompagnement en situations de vulnérabilités.
Parmi les principes que défend le référentiel, lequel vous tient le plus à cœur ?
Pas un plus qu’un autre ! Je suis sociologue et engagée : si on ne tient pas compte des vulnérabilités sociales, je suis malheureuse. Si on est dans un soutien à la parentalité super généraliste, je m’en vais… Mettre l’enfant au centre, ce sera toujours fondamental, et aller vers une émancipation aussi. J’ai vu des cas où l’on a dérapé dans un sens ou dans un autre. De vieux réflexes perdurent, comme le fait de regarder les parents de haut, la difficulté d’avoir un vrai dialogue avec eux, la difficulté aussi de mettre l’enfant au centre quand on est pris dans des tensions économiques ou autres. Parce qu’on n’est jamais dans une situation où les parents vont être d’emblée des acteurs partenaires, parce qu’on arrive, nous, avec notre « savoir » … Donc non, ce n’est jamais gagné, et c’est toujours quelque chose qui prend du temps.
Est-ce que ce référentiel a fait bouger les lignes ?
Je crois qu’il a fourni des balises communes aux professionnels et permis d’éviter certaines dérives. Maintenant, ce qu’il faut dire aussi, c’est que la vulnérabilité des familles se renforce. Les deux parents doivent travailler et il y a un manque de places d’accueil, par exemple. Or il y a des gens qui ont des trajectoires tellement difficiles qu’on imagine mal comment ils font si en plus ils n’ont pas de solution de garde… Je trouve que la parentalité est de plus en plus difficile à assumer, que le contexte social n’est guère favorable à la parentalité. Des ASBL sont en difficulté avec du personnel en burn-out, avec des statuts précaires, aussi. Aujourd’hui, je mettrais encore davantage l’accent sur le travail en réseau, tout en gardant l’idée d’universalité du soutien à la parentalité. J’insiste également sur le langage commun.
Quelle définition donnez-vous de la parentalité, du soutien à la parentalité ?
La parentalité, c’est un regard d’adulte sur les enfants et une volonté de les faire grandir du mieux possible compte tenu du contexte de vie et des histoires vécues. Avec un peu toujours l’idée « qu’on fait ce qu’on peut ». Nous avons beaucoup discuté des termes utilisés et certains professionnels préféraient l’idée d’accompagnement parental plutôt que de soutien à la parentalité. Les deux termes figurent dans le référentiel. L’important pour moi, c’est de miser sur les parents et de construire un dialogue avec eux. Les parents posent beaucoup de questions sur l’avenir de leurs enfants. C’est pourquoi je mettrais aussi en exergue la nécessité d’un soutien à la parentalité à travers des activités collectives. C’est important pour les parents de se rendre compte que d’autres familles vivent des situations semblables et c’est important que les expériences de soutien à la parentalité deviennent des lieux d’échanges où les parents peuvent évoquer leurs besoins et en discuter avec des pairs, où l’on peut sortir de l’isolement et cesser de croire qu’on est seul à vivre ces difficultés, qu’on est seul responsable ou seule victime.
2. « Le référentiel pose des bases qui s’adressent à l’ensemble des professionnels »
Geneviève Bazier, Directrice actuelle de la Direction Recherche et Développement de l’ONE.
Comment définir la parentalité et le soutien à la parentalité ?
Il y a d’abord tout ce qui concerne l’exercice de la parentalité, le fait que les parents exercent sur leur enfant une série de droits et de responsabilités. C’est là qu’intervient cette notion d’accompagnement et de soutien à la parentalité : permettre aux parents de valoriser leurs compétences, de les développer ou de faire émerger des compétences, qui bien souvent sont là, mais qui doivent être accompagnées et soutenues. Dans la parentalité, et surtout dans l’exercice de la parentalité, il y a une dimension individuelle et une dimension collective. L’approche communautaire, peut-être parfois plus politique, consiste à dire qu’il faut, pour que les parents puissent exercer leur parentalité dans de bonnes conditions, dans le respect des droits de l’enfant et même s’ils sont dans des situations particulières qui ne leur permettent pas d’être au top dans l’exercice de leur parentalité (je pense à des parents maltraitants), qu’il y ait des services à disposition pour les accompagner, les aider de manière à ce que cet exercice de la parentalité soit suffisamment optimal. C’est quelque chose de transversal et c’est pour cela que, selon moi, le soutien à la parentalité ne doit pas faire l’objet que d’un seul Ministère. C’est l’ensemble des compétences ministérielles, qu’elles soient communautaires, régionales ou même fédérales, qui à un moment donné doivent s’accorder pour prendre des mesures ou créer des services ou mener des actions pour permettre aux parents d’exercer cette parentalité. Pour les soutenir dans l’expérience de leur parentalité.
Vous parlez de transversalité : on imagine le logement, l’aide sociale, l’organisation des crèches…
Soutenir la parentalité, c’est soutenir les parents qui ont des occupations – et pas nécessairement un travail rémunéré – et qui ne savent pas s’occuper de manière optimale de leur enfant, pour leur permettre de continuer à exercer leur parentalité malgré la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc ce sont tous les services d’aide sociale, dont l’AViQ avec la branche handicap notamment… C’est vaste. L’ONE ne pouvait pas construire ce référentiel tout seul, car il s’adresse à l’ensemble des professionnels qui, dans leur mission, accompagnent, rencontrent, cheminent avec les parents au quotidien.
Ces partenaires du référentiel sont en toute logique l’Aide à la Jeunesse et le Délégué général aux droits d’enfant ?
Exactement. Le soutien à la parentalité, ce n’est pas que des actions prises pour les parents, c’est aussi une mesure qui s’inscrit dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
« On ne naît pas parent, on le devient », illustrait la dessinatrice Cécile Bertrand dans le référentiel. Cela rejoint l’importance du communautaire, de l’environnement dont vous parlez ?
L’expérience de la parentalité se développe au fil du temps et il faut pouvoir intervenir, soutenir, accompagner pour permettre que cette expérience se passe dans les meilleures conditions possibles pour le parent, mais également pour l’enfant. Je prendrai l’exemple des espaces « Parents dans la séparation ». Ce sont des lieux créés récemment pour les parents qui sont en train de se quitter et dont l’objectif n’est pas de gérer cette séparation, mais d’accompagner l’exercice de la parentalité dans cette séparation. Ce dispositif rappelle aux parents qui ne s’entendent plus, qui ont des reproches à se faire, qu’un enfant est là, au milieu d’eux, et qu’ils restent ses parents.
Le référentiel est complété par des satellites, qui sont des documents plus spécifiques. Quels liens entre ces ressources ?
Le référentiel pose des bases qui s’adressent à l’ensemble des professionnels, tous secteurs confondus. Les satellites sont plus ciblés, ils déclinent les principes et les balises du document-noyau au regard de contextes un peu particuliers. Dans les milieux d’accueil par exemple, ces principes et ces balises vont résonner différemment puisque les professionnels qui y travaillent sont moins en contact direct avec les parents. Toutefois, le soutien à la parentalité fait partie de manière plus ou moins directe de leur mission. Voilà d’où est né le satellite « Soutien à la parentalité dans les lieux l’accueil ». Un autre satellite en cours de rédaction concerne le secteur périnatal, un domaine où les principes et les balises ne vont pas non plus s’appliquer ou résonner de la même manière que dans les autres pratiques d’accompagnement à la parentalité. Idem pour les situations de vulnérabilité, qui font aussi l’objet d’une approche spécifique.
Tout comme la société, le référentiel évolue ?
Quand nous l’avons conçu, nous ne nous sommes pas dit que nous allions gérer, entre autres, la problématique de la séparation des parents. On ne se retrouve plus avec les mêmes configurations familiales et on ne se retrouve plus non plus dans les mêmes relations interpersonnelles qu’auparavant. On parle beaucoup de repères dans le référentiel, et ce qui est nouveau dans l’exercice de la parentalité ou dans le soutien de la parentalité, c’est notamment l’influence des réseaux sociaux. Avant, on était conseillé par sa mère ou sa sœur, par une amie… c’était quelque chose qui relevait de la sphère privée. Aujourd’hui les parents ont beaucoup d’informations à leur portée, et des informations souvent contradictoires, mais ils ont de moins en moins de repères. Chacun y va de son vécu personnel et ils sont souvent complètement perdus, et beaucoup plus stressés. Cela amène aussi pas mal de burn-out parental : on ne sait plus où on en est. Les configurations familiales ont également changé. Il y a de plus en plus de familles recomposées ; on en parle peut-être moins alors que les situations peuvent être compliquées : avoir des enfants biologiques issus du couple recomposé avec des demi-frères, des demi-sœurs qui viennent du papa, qui viennent de la maman… Cela crée des familles un peu particulières, avec des parentalités différentes. Il y a aussi les familles monoparentales, les familles homoparentales, les mères célibataires et quelque chose dont on ne parlait pas il y a quelques années : la paternité. Il est en effet beaucoup question de maternité, de lien mère-enfant, mais très peu de lien père-enfant… or le papa est bien là et il est de plus en plus présent et concerné, il faut tenir compte dans la parentalité.
On peut imaginer qu’il y aura des satellites du référentiel sur ces sujets-là ?
Les satellites portent plutôt sur des situations : la vulnérabilité, le périnatal. Peut-être faudra-t-il à un moment donné revisiter le référentiel « Soutien à la parentalité » en y intégrant ces dimensions-là… En attendant, le carnet des parents, qui est aujourd’hui distribué dans les consultations de l’ONE, va être augmenté d’un chapitre sur la place du père.
Le référentiel contient des balises. Laquelle vous semble essentielle ?
« Tous les parents ont des compétences. » Cela ne veut pas dire que tous les parents sont compétents, mais je pense que tous les parents ont des compétences potentiellement, des capacités. Cela permet de ne pas mettre les parents dans des cases. Il y a une forme d’égalité au départ, mais on sait que tout le monde n’a pas les mêmes chances de pouvoir exprimer ses compétences… Chez chacun, des leviers peuvent être activés par les actions que les professionnels mènent. Le soutien et l’accompagnement que l’on peut apporter, leur intensité, sera aussi de nature différente en fonction de ce que le parent nous montre à voir de ses compétences. Celles-ci sont malheureusement parfois effacées par une série d’expériences négatives, et il faut peut-être les réactiver.
Accompagner le parent, le soutenir, c’est agir avec lui ?
Absolument. Parfois les professionnels sont tellement enfermés dans leur mission de base qu’ils oublient cette notion : le parent que j’ai devant moi a des compétences, je ne les vois peut-être pas ou elles ne sont peut-être pas affirmées, mais qu’est-ce que je peux faire, moi, pour aller les chercher ?
Même si le parent n’est pas là physiquement ?
Oui. Des parents, un père ou une mère qui sont en prison par exemple.
Quel principe du référentiel mettriez-vous en avant ?
« Prendre le temps de l’analyse. » Je pense que les professionnels n’ont pas ce temps ou ne le prennent pas. Or c’est important de l’avoir, ce temps. C’est aussi quelque chose que l’on peut renvoyer aux politiques et aux responsables de services : on peut faire tout ce qu’on veut dans les actions de soutien à la parentalité, mais si on ne renforce pas les équipes pour leur permettre d’avoir du temps pour l’analyse, on loupe quelque chose. C’est de l’argent perdu, c’est du temps perdu. Pour mener un travail de qualité, il faut soutenir les professionnels, car beaucoup s’épuisent littéralement dans le soutien à la parentalité, ils se sentent démunis, ils se sentent impuissants, ils voient de nombreux parents, ils voient de nombreuses situations différentes… On ne peut pas non plus travailler en réseau si on ne prend pas du recul par rapport à ce que l’on voit.
Un mot sur le site www.parentalite.be, un carrefour de l’information relative au soutien à la parentalité ?
Avant d’être hébergé par le l’ONE, le site www.parentalite.be dépendait de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ). C’était une sorte d’annuaire de services par région et par secteur qui faisaient du soutien à la parentalité. Son objectif était d’aider les professionnels à mieux se connaître et réseauter. Lorsque le référentiel est sorti, il a tout naturellement contribué à élargir cette ressource et permis aux professionnels une approche réflexive de leur pratique. La technologie évoluant, le site propose en outre une documentation importante, des vidéos, des témoignages, des interviews et des podcasts. L’annuaire s’est étoffé, ce n’est pas une simple liste d’adresses. Nous proposons aux personnes et aux services qui y sont référencés de réaliser une capsule de présentation, ce qui donne des idées à d’autres dans le secteur. En informant le réseau des nouveautés, cela crée de l’émulation.
Quel usage les professionnels font-ils de ces outils ? Comment sont-ils incités à s’en servir ?
Un Comité d’Accompagnement (dont sont membres, entre autres, l’ONE, l’Aide à la Jeunesse, l’AViQ, l’Enseignement, le Délégué général aux droits de l’enfant et le Fonds Houtman) se réunit régulièrement pour voir comment faire évoluer le référentiel et le site ; à charge de chaque secteur de mener ensuite des actions d’information, de formation, de sensibilisation auprès de leurs professionnels respectifs, ou ensemble. Les évènements DéPaR, les « Débats Parentalité en Réseau », sont des moments fédérateurs. Chaque année, ils réunissent tous les professionnels qui font du soutien à la parentalité, tous secteurs confondus. On y présente le référentiel et le site, et des échanges sont organisés autour d’une thématique particulière aussi développée sur www.parentalite.be. Nous formons également les futurs professionnels amenés à faire du soutien à la parentalité. Nous présentons le référentiel aux hautes écoles d’infirmières, de sage-femmes, d’assistants en psychologie, d’assistants sociaux, d’éducateurs, etc. Nous les approchons généralement en dernière année d’études : ils seront bientôt diplômés, ils ont déjà effectué des stages, ils ont déjà une forme de pratique. Et on les invite à s’inscrire sur le site !
3. « Pouvoir offrir au parent d’occuper la juste place »
Marie Thonon, Référente en intersectorialité pour le secteur de l’Aide à la Jeunesse. Lors de la création du référentiel, elle travaillait à l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse, à la Direction SAJ/SPJ et était en charge des collaborations avec l’ONE.
Le référentiel est un partenariat entre plusieurs grosses institutions liées à l’enfance. Quelle est la part de l’Aide à la Jeunesse ?
Historiquement, l’Aide à la Jeunesse et l’ONE sont des partenaires évidents, obligatoires, puisque nos publics se chevauchent, se croisent. Pour une série de problématiques, nous sommes tous deux compétents, mais chacun avec nos compétences particulières. Nous avons donc des protocoles de collaboration, l’un entre les SAJ/SPJ et les PEP’s de l’ONE, l’autre entre les SAJ/SPJ et les équipes SOS Enfants. Ces protocoles se veulent très pragmatiques et ont pour visée d’améliorer la collaboration entre les deux secteurs, de savoir exactement qui s’adresse à qui et comment pour garantir la cohérence de nos interventions. Construire ces protocoles a déjà permis de mieux se connaître et de s’accorder sur les mots. Comment on se positionne, de quoi on parle, qu’est-ce que cela signifie, comment est-ce qu’on le met en pratique, etc. C’est important d’être cohérent, mais pour cela il faut parler le même langage, et ce n’est pas si simple ! La notion de danger, par exemple, la notion d’urgence, sont interprétées de manière différente d’un secteur à l’autre, et même au sein d’un même secteur parfois. Une jeune déléguée qui sort de l’école et qui débute dans un SAJ n’aura pas le même seuil qu’une déléguée qui bénéficie de vingt années d’expérience. Une PEP et une déléguée doivent aussi pouvoir s’accorder sur les priorités, les temporalités. S’ajoute à cela cette question transversale de la parentalité, de la place des parents, cette notion de compétences parentales… La construction du référentiel de soutien à la parentalité était un canal très intéressant pour travailler cette cohérence et développer une vision commune. Des formations locales ont ensuite été coorganisées, et c’était de nouveau l’occasion pour nos acteurs de terrain de se rencontrer. Cela crée des relations interpersonnelles, chacun apprenant à comprendre la réalité de l’autre. On fantasme toujours un peu sur ce que l’autre va pouvoir faire, sur les moyens dont il dispose. Cela permet de démystifier tout cela, d’être plus objectif.
Comment vit aujourd’hui ce référentiel dans vos services ?
Des formations sont prévues pour tous les nouveaux agents, un petit module obligatoire, le kit de départ dans la fonction. Tout au long de leur pratique aussi, les services utilisent régulièrement le référentiel pour ramener le cadre et resituer. C’est un outil qui est intégré à notre site. Les services recourent également aux différents satellites en fonction de leur réalité de terrain.
Vous participez aussi au site www.parentalite.be ?
Oui. C’est un canal particulièrement intéressant parce qu’il brasse très large. Le référentiel y trouve évidemment sa place en tant qu’outil pour nos professionnels. Je fais partie du groupe de travail « Thématiques » aussi, qui réfléchit, comme son nom l’indique, aux thématiques à travailler, et qui construit ce qui est diffusé sur le site, notamment des interviews de différents acteurs de l’Aide à la Jeunesse. Ce groupe est constitué d’une série de personnes-ressources, il est intersectoriel puisque le soutien à la parentalité traverse tous nos secteurs. Ce site rassemble tous les supports susceptibles d’aider nos professionnels ; c’est précieux, car nous avons à la fois un turnover important dans nos services et un renforcement du secteur. Pas mal de nouveaux agents qui arrivent donc, et qui peuvent y trouver facilement des balises, des outils – même si tout cela est travaillé en équipe évidemment, avec les délégués-chefs, dans les contacts entre les délégués et les PEP’s ou les équipes SOS Enfants. On peut aussi avoir besoin de prendre un peu de hauteur par moments, de suivre une approche un peu plus théorique. Pour cela, le référentiel et le site sont très pertinents et toujours à disposition.
Quel principe, quelle balise mettriez-vous en exergue ?
À chaque fois que l’on aborde cette question de parentalité, de soutien, d’accompagnement, je reviens avec la notion de juste place du parent. Pouvoir offrir au parent d’occuper la juste place, et donc aider à définir quelles sont ses ressources : à partir de quand et jusqu’où est-ce qu’il peut assurer son rôle de parent ? Nous devons pouvoir respecter cela en tant que professionnels, nous adapter et venir là où le parent ne peut pas, lui, assurer sa parentalité. La juste place que le parent peut prendre doit être identifiée le plus rapidement possible, sinon on le met en échec, et in fine il peut abandonner complètement son rôle de parent. C’est un constat de nos suivis. Tandis que, si très rapidement on lui offre une place là où il peut la prendre, alors il restera le plus longtemps possible dans la situation. Oui, les parents ont des compétences, mais elles sont aussi parfois limitées. Il faut arriver à aller les chercher. Et les compétences, ce n’est pas juste héberger, nourrir, conduire à l’école… d’autres peuvent être amenées.

C’est un peu tout notre système que je remets en question. En tant que professionnel, on est parfois sur des rails… or il faut être plus intensif dès le départ pour bien identifier les besoins de l’enfant, les besoins des parents, les compétences de l’enfant, les compétences du parent et construire quelque chose qui va permettre à chacun d’être à sa juste place. Un exemple : se rendre compte que la prise en charge de leur enfant vingt-quatre heures sur vingt-quatre est compliquée et offrir aux parents un hébergement (pas en tant que sanction) va leur permettre d’être là de manière adéquate pour leurs enfants dans la limite de leurs compétences, et d’être là plus longtemps.
Ce référentiel vient-il uniquement en soutien des familles en difficulté ?
C’est pour eux que ce guide est conçu, mais il doit aussi autoriser n’importe quel parent à un moment donné à être en difficulté. Une maman dans une maison spacieuse, chauffée, qui est en couple, qui a de la famille qui peut l’aider, qui a tout pour que ça se passe bien, peut un jour être en difficulté. Si on peut la soutenir dès que quelque chose d’un peu compliqué apparaît, on évitera certainement que la situation dérape. Il ne s’agit pas de remettre en question les compétences de tout le monde, mais de reconnaître à tout le monde le fait que sa parentalité n’est pas simple. Quel que soit le contexte, tout parent a le droit à un moment donné de solliciter de l’aide. Certains vont la trouver auprès de leurs proches et d’autres pas, même s’ils sont bien entourés.
Ce n’est pas un processus linéaire d’être parent…
Non.
4. « La transversalité est essentielle »
Stephan Durviaux, Criminologue, Conseiller alors auprès du Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE).
Quel est l’enjeu de ce référentiel et en quoi fait-il date aujourd’hui encore ?
Un des points focaux du référentiel, c’est de placer l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur des préoccupations dans l’exercice de la parentalité. Cela avait donc énormément de sens pour une institution comme le Délégué général aux droits de l’enfant de collaborer avec les deux grands organismes que sont l’ONE et l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse. À l’époque, des travaux menés par notre institution avaient mis en évidence que la pauvreté des familles impactait celle des enfants et c’est tout naturellement que nous avons décidé de collaborer à l’écriture du référentiel, même si un travail avait déjà été entamé de manière approfondie par l’ONE. C’est intéressant aussi de faire le lien entre un organisme plutôt généraliste dans son contact avec les enfants – tel que l’ONE et sa mission d’accueil et d’accompagnement – et l’Aide à la Jeunesse où le prisme est différent, puisqu’on y traite de situations d’enfants qui présentent des vulnérabilités ou qui se trouvent dans des situations de difficulté ou de danger. Le Délégué général a trouvé sa place entre ces deux pôles et nous avons pu mettre en lumière la question du droit de l’enfant, qui est notre spécificité. La transversalité est essentielle et, au-delà de la rédaction du référentiel, faire se rencontrer des travailleurs de l’ONE et des travailleurs de l’Aide à la Jeunesse pour les amener à utiliser un langage commun et manier des concepts et des pratiques professionnelles parfois différents avait également énormément de sens.
Le DGDE apporte une sorte de caution morale ou de l’ordre de l’éthique ?
Oui, mais j’estime que la référence de l’ONE et de l’Aide à la Jeunesse est déjà en soi un gage de qualité ! Les administrations sont parfois tellement prises dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes qu’il est parfois bon de réfléchir, ensemble qui plus est, au sens des interventions. Les droits de l’enfant sont la pierre angulaire de notre institution, ce n’est pas un secteur comme peuvent l’être l’ONE et l’Aide à la Jeunesse ; nous ne sommes pas une administration, nous n’avons pas de professionnels qui travaillent avec nous sur le terrain… Quand l’un ou l’autre secteur met en évidence une thématique, une problématique, nous pouvons apporter un regard différent qui est fondé sur la Convention internationale des droits de l’enfant, sur notre pratique des situations individuelles et des plaintes qui nous sont amenées. Dans le cadre de cette mission, nous sommes aussi confrontés à une série de questions liées à la parentalité et nous apportons notre pierre à l’édifice à travers le prisme des droits de l’enfant.
Un tel lieu de réflexion partagé, c’est essentiel ?
Tout à fait. Ce qui est intéressant, comme je le soulignais, c’est de travailler sur un langage commun. Amener deux secteurs différents à manier une série de concepts, de pratiques professionnelles qu’ils n’utilisent pas toujours de la même manière dans un objectif commun était assez stimulant : « Nous, on utilise un certain vocable, un certain nombre de termes… est-ce que ça a le même sens chez vous ? ». Par rapport à la question de la maltraitance, par exemple, il y a les équipes SOS Enfants au niveau de l’ONE, les SAJ et SPJ au niveau de l’Aide à la Jeunesse. On sentait parfois qu’on ne parlait pas le même langage ; or c’est important de pouvoir se poser et réfléchir à quelque chose qui donne du sens de chaque côté. Et en termes de pratiques professionnelles, je passe sur les disparités régionales qu’on ne s’explique pas toujours, et qui tiennent parfois à des questions de personnes. On appréhende parfois les choses de manière différente à Liège, à Charleroi ou à Bruxelles.
Ce référentiel a harmonisé les pratiques ?
Je pense. Enfin, c’était un objectif et le référentiel y contribue sans doute même si on ne peut pas prétendre y être complètement arrivé. Ce référentiel, c’est d’une part l’aboutissement de quelque chose, mais également un point de départ. Se dire que ce n’est pas un travail fini, que c’est un travail en construction constante, nous amène en tant que professionnels à nous remettre sans cesse au travail.
Les mots, c’est important. Et un sur lequel il a fallu s’accorder, c’est le titre du référentiel…
Il faut replacer les choses dans le contexte de l’époque. Quelques années auparavant, en 2006, au niveau fédéral, on venait d’adopter la législation sur le stage parental dans un contexte politico-sociologique de responsabilisation des parents et avec des réflexions telles que : pour faire respecter l’obligation scolaire, ne doit-on pas supprimer les allocations familiales ? Qu’est-ce que les parents peuvent apporter ou n’apportent pas lorsque leurs enfants font des bêtises ? Un questionnement qui n’a pas complètement disparu… Pour certains, les parents, considérés comme défaillants, étaient les responsables de tous les maux. On avait une vision de la famille modèle stéréotypée, et celles qui ne correspondaient pas au moule devaient être soutenues. Or, les familles sont par essence plurielles. En travaillant sur ce référentiel, la volonté était aussi de montrer cet état des choses. Le référentiel mettait en lumière la diversité, la richesse des nouveaux modèles familiaux. Cela évolue encore et les familles monoparentales, homoparentales, etc., sont susceptibles de nous faire réfléchir et adapter notre manière d’appréhender les choses – même si les fondamentaux et les grandes balises demeurent.
Si vous aviez à choisir une seule balise du référentiel, laquelle mettriez-vous en avant ?
La question de l’intérêt de l’enfant. C’est le prisme par lequel nous avons essayé d’apporter notre contribution. En fonction des positionnements professionnels, cet intérêt peut avoir des conceptions parfois fort différentes. Si vous demandez à un thérapeute, un travailleur social ou un éducateur ce qu’est l’intérêt de l’enfant, je pense que vous pourrez obtenir trois réponses différentes pour une même situation individuelle.
5. « Nous essayons de nous détacher du langage institutionnel »
Nathalie Van Cauwenberghe, Criminologue auprès du Délégué général aux droits de l’enfant, Cellule plainte et médiation institutionnelle.
Quelle place occupe aujourd’hui le DGDE dans ce partenariat à l’initiative du référentiel ?
Au niveau du site www.parentalite.be, un Comité d’Accompagnement Stratégique se réunit en général une fois par an avec les responsables de l’ONE, la Cellule Soutien à la parentalité de l’ONE, l’Aide à la Jeunesse, le Délégué général aux droits de l’enfant, l’AViQ et des experts. Le Fonds Houtman en fait aussi partie. Un groupe de travail plus large se réunit plus souvent pour réfléchir aux thématiques à mettre en avant sur le site www.parentalite.be. Chacun apporte sa contribution et met en évidence des éléments spécifiques à son secteur. Je fais partie des deux organes. Pour le moment, nous rédigeons avec des personnes compétentes dans ce domaine un texte sur l’hébergement des enfants en dehors de leur milieu familial, en mettant le focus sur le soutien à la parentalité. Nous suggérons des lieux intéressants à rencontrer ou à interviewer. Nous discutons longuement sur les contenus, car chacun a son cadre de travail et le but est plutôt de l’élargir afin de ne pas imposer de vision trop restrictive, pour que l’information soit ouverte à tous les professionnels. Nous essayons de fonctionner par entonnoir, en proposant une information assez générale et aussi la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent d’aller plus loin en fournissant des pistes plus précises. En matière d’Aide à la jeunesse, les pratiques diffèrent parfois d’un arrondissement judiciaire à l’autre, même si la tendance est à leur harmonisation, un peu comme pour les équipes SOS Enfants – mais il y a des particularités pour chacune. Nous faisons en sorte que les professionnels reçoivent une information cohérente, peu importe d’où ils viennent. Nous essayons de la diversifier pour qu’elle soit plurielle.
Comment déterminez-vous les thématiques développées sur le site ?
Nous y travaillons depuis 2020, et il y a eu pas mal de réunions ! Nous sommes partis du cadre dont les parents avaient vraiment besoin pour être soutenus et nous partons aussi du référentiel. Il y avait vraiment beaucoup de thématiques possibles et il a fallu les restreindre, en intégrer certaines à d’autres. Comme pour le texte sur l’hébergement : il s’agit d’une niche dans une thématique plus générale. Il y a eu beaucoup de discussions, sans se froisser les uns les autres, car chacun vient avec sa logique, et c’est cela qu’il faut mettre à l’épreuve. La mienne est de toujours avoir une attention particulière au niveau des droits de l’enfant. Nous devons arriver à un résultat commun et le mettre en parallèle avec le soutien à la parentalité. C’est là que nous devons aller, et ne pas nous égarer en route.
Le site est donc en perpétuelle construction ?
L’idée, c’est qu’il continue à être alimenté. Nous nous étions fixé un certain nombre de thématiques ; sept d’entre elles sont déjà en ligne : isolement social, adoption, assuétudes, handicap, maltraitance de l’enfant, migration/immigration et santé mentale. D’autres devront être développées par la suite. Il contient également des capsules vidéo, que je trouve très chouettes pour les professionnels. Elles présentent des services et nous en extrayons des mots clés, des références qui font soutien à la parentalité. On écoute et on lit à la fois. Beaucoup de ressources existent et c’est dommage d’en faire l’économie. Nous les rassemblons sous un onglet « Pour en savoir plus ». Cela permet de pousser plus loin la réflexion.
Quelle est la particularité de votre présence dans ces instances ?
J’y viens avec mon approche « droits de l’enfant », c’est quelque chose que je garde toujours à l’esprit. Chez le Délégué général, je fais partie de la Cellule plainte et médiation institutionnelle, donc j’ai des retours du terrain sur ce qui dysfonctionne très fort puisque, quand on arrive chez nous, c’est que les autres voies sont épuisées. J’ai parfois une vision un peu tronquée parce que je vois ce qui ne va pas bien. Ce qui est riche, c’est de pouvoir confronter ce point de vue à celui d’autres et que cela puisse alimenter les débats entre nous pour que quelque chose émerge. Finaliser la rédaction d’un texte pour le site prend beaucoup de temps parce que nous essayons d’être fidèles à la pluralité du terrain, d’être accessibles à la pluralité des intervenants et des professionnels et à tous les niveaux. Nous devons aussi être précis. Par rapport à l’hébergement d’un enfant, chez le DGDE, nous parlons d’hébergement en dehors de son milieu de vie, d’autres parlent d’hébergement en dehors du milieu familial… On parle aussi de placement… À un moment, il faut trancher et décider de quoi on parle. L’idée, c’est que cela fasse ressource pour la majorité des gens, et qu’ils puissent comprendre. Nous essayons aussi de nous détacher du langage institutionnel. Chacun a son jargon, et parfois c’est bien de simplifier les choses… mais en même temps, il y a des termes qu’il faut pouvoir comprendre. Pour les expliciter, nous composons des glossaires.
Des mises à jour sont prévues ?
Quand les textes sont mis en ligne, c’est qu’ils ont été suffisamment révisés. Maintenant, quand des modifications sont nécessaires, il faut pouvoir les apporter, mais nous ne sommes pas encore dans cette phase-là. Nous sommes pour le moment dans une phase d’alimentation. Ce groupe de travail sur les thématiques planche aussi sur celles qui vont alimenter les DéPaR – les Débats Parentalité en Réseau, des rencontres annuelles avec des professionnels. À l’issue de ces échanges, un sondage recueille leurs propositions pour l’édition suivante. Les choix viennent aussi des préoccupations du terrain.
Quelle est pour vous la balise la plus importante du référentiel ?
L’enfant. C’est essentiel, mais finalement l’enfant tout seul ne peut pas fonctionner. Partir des compétences des parents et les soutenir, j’ai l’impression que c’est ce qui fonctionne le mieux. Quand j’entends les témoignages de parents qui ont bénéficié de l’accompagnement de services qui font du soutien à la parentalité – c’est beaucoup de travail de la part de ces professionnels et souvent dans la durée, je me dis qu’il faut peu de choses pour que les parents se réapproprient leurs compétences, qu’ils les ont en eux et qu’il suffit parfois de les étayer pour qu’elles deviennent solides. Oui, partir de leurs compétences à eux, c’est ce qui me semble vraiment à valoriser. Dans une société de plus en plus individualiste, ces projets-là ont beaucoup de sens.
6. « Nous faisons aussi confiance au terrain »
Virginie Pasqua, Aurélie Dupont et Eleonora Bianchi, Gestionnaires de Projets et Membres de la Cellule Soutien à la parentalité de l’ONE.
Quel est le rôle de la Cellule Soutien à la parentalité de l’ONE ?
À l’exception du carnet « Devenir et être parent, toute une aventure », qui s’adresse directement aux familles, la plupart de nos productions et communications sont destinées aux professionnels. Notre rôle est de les aider dans la réflexion sur leur pratique d’accompagnement de la parentalité et de leur fournir des supports. Cela se fait à travers plusieurs projets, mais le fondement, c’est le référentiel, le document « Pour un accompagnement réfléchi des familles ». Nous le mettons en exergue dans nos communications, dans nos formations, dans nos écrits… On y revient tout le temps !
Des exemples ?
Pour la contribution au satellite « L’accompagnement des familles en situation de vulnérabilités psychosociales » et à celui en cours sur « Le soutien à la parentalité en période périnatale », nous avons exploité et vu comment le référentiel et les principes et balises de base du soutien à la parentalité faisaient sens et comment ils s’exprimaient dans ces deux champs en particulier. Lorsque nous avons mené une recherche sur les dispositifs à destination des (futurs) papas dans le champ de la périnatalité et de la petite enfance*, nous avons aussi repris les quatre grands principes du soutien à la parentalité. Ils sont liés, ils forment un tout et nous n’y dérogeons pas.
* « Dispositifs à destination des (futurs) papas dans le champ de la périnatalité et de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles », Christine Godesar, Chercheuse à la Direction Recherche et Développement de l’ONE, 2020.
C’est la garantie de tous les projets actuels et à venir ?
Nous nous y référons à chaque fois que nous sommes sollicitées pour une question externe, comme une question parlementaire par exemple. Dernièrement, nous avons rencontré l’AViQ – l’un des partenaires du site www.parentalite.be – qui nous demandait s’il était possible d’intégrer sur cette plateforme des services généralistes qui mettent sur pied des projets, des actions, des formations et qui ont de l’expertise à partager avec d’autres professionnels de l’accompagnement des parents d’un public cible précis, notamment les parents en situation de handicap. Nous avons quelque peu réduit la demande initiale en faisant appel au référentiel. Qu’est-ce qu’on entend par soutien à la parentalité ? Qu’est-ce qu’on entend par réseau ? Effectivement, le référentiel est un point de départ, une base, il pose le cadre, les principes, les balises qu’il faut toujours garder en tête, les postures professionnelles qu’il vaut mieux avoir afin de rencontrer vraiment les familles. Il faut une base pour démarrer la réflexion.
Le site www.parentalite.be, à destination des professionnels, contient un annuaire de services et leurs projets de soutien à la parentalité. Quels sont les critères pour y figurer ?
Nous nous appuyons sur des critères d’inclusion en lien avec les principes du référentiel, et aussi sur les partenaires, sur le fait que les services répertoriés ont été agréés, reconnus, soutenus d’une manière ou d’une autre par un des partenaires ou qu’un des partenaires a fait partie d’un jury pour un des projets présentés. Nous faisons aussi confiance au terrain.
Quelles sont les autres pages du site ?
Un onglet « Thématiques » aborde des situations, des contextes que les familles pourraient traverser à un moment donné. Il fournit des informations à partir d’une définition commune. Ce langage commun fait partie du cadre du référentiel : un langage qui parle à tous les professionnels. Il donne également des pistes de réflexion aux professionnels, une série de situations, de portes d’entrée. Il leur donne les ressources et les réseaux existants qui peuvent leur fournir des informations complémentaires s’ils le souhaitent. Ici, à la différence de l’annuaire, on ne retrouve pas des ASBL ou des projets spécifiques, mais plutôt des services qui ont dans leurs missions la thématique en question.
Nous présentons encore des capsules vidéo où nous partageons des interviews de professionnels de terrain qui donnent leur vision, leur approche, leur méthodologie, leurs outils d’accompagnement des familles. Nous mettons en avant des nouveautés pour tout professionnel en contact direct ou indirect avec les familles, en partageant également des évènements, des actualités législatives, des publications de recherches, des appels à projets liés à l’accompagnement et au soutien à la parentalité. Une newsletter offre à ses inscrits une sélection des nouvelles parutions.
Un mot sur le projet DéPaR ?
DéPaR, ce sont des « Débats Parentalité en Réseau », des évènements annuels construits à partir du site www.parentalite.be et avec les partenaires à destination des professionnels dans le but de se rencontrer et d’échanger sur une problématique en particulier en lien avec les pratiques de terrain. C’est à partir du référentiel que nous les construisons. La dernière édition a porté sur la continuité de l’accompagnement et nous nous sommes beaucoup arrêtés sur le sujet du réseau. La prochaine aura lieu le 1er avril 2025, elle portera sur l’isolement des familles : les pistes et les défis du soutien à la parentalité.
Quelle est la place aujourd’hui de l’Aide à la Jeunesse et du Délégué général aux droits de l’enfant, les partenaires initiaux du référentiel ?
Ils participent à de nombreuses réflexions et initiatives de la Cellule Soutien à la parentalité. Par exemple, en ce qui concerne le site www.parentalite.be, leurs représentants, ainsi que d’autres partenaires du site tels que l’AViQ, le Fonds Houtman, l’enseignement, l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (OEJAJ) et la COCOF, restent des personnes-ressources pour toute réflexion, recherche et relais vers le terrain ; le but étant de garantir une vision intersectorielle aux contenus publiés. Ils font également partie du Comité d’Accompagnement Stratégique du site www.parentalite.be, qui se réunit environ une fois par an pour un moment de validation de ce qui a été réalisé pendant l’année précédente et pour valider les perspectives.
Comment le référentiel est-il reçu lors des formations ?
Les formations permettent de continuer à faire vivre le référentiel et de le partager. Les participants ne vont certes pas apprendre des choses nouvelles, nous ne leur apprenons pas des savoirs : le savoir, ils l’ont déjà. En revanche, les savoir-être et cette réflexion sur les pratiques… Ils vont peut-être se décaler, voir les choses avec d’autres lunettes, essayer ce que d’autres ont essayé… Quand on est sur le terrain, quand on est face à des familles et que des familles viennent nous chercher dans qui nous sommes, dans nos représentations, etc., ce n’est pas si facile que ça. C’est le message que nous faisons passer.
La recherche sur les (futurs) papas illustre à la fois l’évolution de l’ONE et celle de la société. Une preuve d’adaptabilité aux situations contemporaines ?
On l’espère. C’est notre volonté. Maintenant, on sait que ça prend énormément de temps. Il faut que le message soit validé institutionnellement. Dans le satellite « Soutien à la parentalité en période périnatale », on va même plus loin, on parle de diversité de genre, d’identité de genre, on parle des personnes transgenres. Comment est-ce que je fais quand je suis face à une personne qui ne s’identifie pas au genre auquel elle pourrait s’identifier ? Comment ne pas faire faire de bourdes ? Ce sont des réalités auxquelles les professionnels sont confrontés, donc on ne peut pas faire sans. Nous croyons beaucoup au bottom-up. On ne peut pas faire de travail de qualité sans prendre en considération les besoins des professionnels auxquels nous nous adressons, mais aussi des familles. Et il faut être prêt à recevoir ce qui remonte du terrain. Quand on dit que les gens doivent être acteurs, il faut accepter une part de lâcher-prise, accepter que cela prenne dès lors un peu plus de temps que si on avait gardé le lead… En tant que pros, sommes-nous prêts à tout cela ? Cela se travaille en partie avec le référentiel !
7. Pour en savoir plus
Le référentiel et ses satellites sont consultables et téléchargeables sur le site www.parentalite.be
Retrouvez aussi plus d’informations sur les partenaires : www.one.be, www.aidealajeunesse.cfwb.be et www.defenseurdesenfants.be